Pour commencer de répondre à ces préoccupations, j’aimerais qu’on réfléchisse aux fortes réactions qui se sont manifestées dans notre ville. Elles émanent de citoyens et citoyennes intéressés au domaine culturel, d’artistes, de milieux professionnels du monde des musées, d’ici, mais aussi d’ailleurs, nous y reviendrons, et de personnes, politiquement engagées, qu’elles soient de droite ou de gauche... Une telle unanimité est rare mais peut-être n’est-elle pas aussi étonnante qu’il y paraît.
Pour le comprendre, une piste, un symbole liés à notre histoire : à l’avenue Léopold-Robert 67, se trouve un bâtiment qui abrite le syndicat UNIA et la caisse de prévoyance de la Fédération horlogère. A l’étage du premier se trouve un tableau d’Aurèle Barraud, et c’est significatif qu’il soit là. A l’étage de la seconde, c’est une peinture de Charles L’Eplattenier qui se laisse découvrir, et qui, elle aussi, est bien à sa place. Ainsi, les associations patronale et ouvrière habitent ensemble, de même que chacun des peintres par l’une de ses oeuvres, peintres marquants et pourtant fort différents.
A la Chx, il y a eu à certaines époques de très forts conflits sociaux et politiques, lesquels ont été produits par la réalité. Mais en même temps, à la Chx, on s’est toujours parlé, ce qui fait aussi partie de notre réalité. Or, un lieu privilégié de ces échanges et de ce dialogue continu par delà les clivages a été la vie associative et culturelle...
Signalons enfin pour mémoire (on comprendra bientôt pourquoi j’utilise ce terme...) que nos musées, notre théâtre, notre salle de musique, ont tous pu être construits grâce à une étroite collaboration entre les secteurs public et privé. Construits, rénovés, agrandis, puisque ce phénomène s’est poursuivi récemment encore.
Quand on lit le rapport du CC sur nos musées, on est déçu de ne pas y voir figurer, même en introduction, quelques considérations sur leur histoire, leurs collections, les grilles de lecture, leurs mises en évidence, les questionnements qu’ils proposent. Non, rien de tout cela. Par contre, une page du rapport aborde notre histoire, dans l’idée de proposer une rupture. Mais ce qui est dit est si sommaire et blessant, si prétentieux, qu’immédiatement se sont manifestées des réactions, fruits des liens qui ont été depuis longtemps tissés.
"Plus on se penche sur l’histoire des musées, plus le poids de cette histoire devient lourd. (...) Faut-il un incendie, comme au XVIIIe siècle pour pouvoir penser autrement, pour pouvoir faire table-rase du passé, finalement trancher le noeud gordien ? "
L’incendie, c’était peut-être le rapport, et le noeud gordien a ceci de paradoxal dans sa symbolique, que, comme l’a signalé avec pertinence David Jucker, professeur d’histoire au Lycée, plus on le tranche violemment, plus il repousse... L’Histoire a effectivement un poids, mais c’est aussi une de ses vertus... Au surplus, elle n’est pas un bloc, mais il y a en elle une évolution. Le développement de nos collections, comme je le montrerai ultérieurement, en témoigne. Enfin, terminons ce point en signalant que le "neuf" n’est ni forcément nouveau, ni, s’il l’est, de qualité... Quant à "penser autrement", ce n’est pas nécessairement penser...
Ainsi, je ne crois pas qu’on puisse vraiment construire l’avenir si l’on méconnaît notre passé.
Bien sûr, notre histoire doit se continuer. Mais que dit le rapport à ce sujet ? "Il faut créer une nouvelle dynamique, dit-il, apporter des améliorations simples à grands effets". Eh bien, voyons : "Les musées de la Chx ne sont pas facilement accessibles à certains publics qui sont intimidés devant ce qu’ils ressentent comme des obstacles". C’est possible... mais quels sont ces publics et sur la base de quelle enquête ont été déterminés leurs problèmes ? "Ils ont la sensation de s’avancer dans une caverne pour trouver les richesses attendues du MIH". Peut-être, mais le MIH est remarquable dans sa conception archtecturale et a été primé à ce titre. "...d’être obligés à pousser une lourde porte pour découvrir une maison de maître au MH ". Les malheureux ! mais il se trouve que cette porte fait justement partie de ce qu’est une maison de maître. "...de devoir oser traverser un hall austère pour approcher les locaux baignés de lumière du MBA". Le hall austère, c’est les mosaïques de Charles Humbert. Faut-il comme moyen simple à grands effets passer un coup de peinture blanche là-dessus pour améliorer l’accueil ? "...et de prendre la peine de monter bien haut et de traverser un couloir bien long pour enfin découvrir les animaux du MHN ". Il y a un ascenseur, l’espace à disposition a été organisé pour montrer non des animaux, mais des mises en situation du monde animal dans notre culture ! "Il est important de briser ces obstacles" conclut cette partie du texte.
Je l’ai cité à dessein parce que je crois que de tels propos vont au contraire augmenter les obstacles, susciter de façon logique et durable des résistances fortes... Pourquoi ? Parce qu’ils montrent que la personne qui les tient appréhende "nos musées" de façon subjective, impressive. Mais elle ne sait pas que ses impressions relèvent de stéréotypes et de clichés au niveau des critères utilisés, ce qui la fait apparaître comme naïve et, dans ce domaine au surplus, ignorante de certaines données de notre patrimoine, qu’elle dévalorise donc ... Et cela, tous les milieux cultivés le voient d’entrée, non parce qu’ils sont "supérieurs", mais parce que, comme d’autres milieux, ils ont une formation, une expérience, des valeurs, des codes et des relations relativement à leur domaine.
Tout s’apprend, mais si vous parachutez une "cheffe" qui est manifestement au début de son apprentissage (dans le domaine en question), des conséquences normales et prévisibles vont en découler, comme partout...
Si le CC a laissé passer de tels propos, c’est qu’il ne les a pas vraiment lus, au sens d’en comprendre les présupposés et la portée. Personne n’est omniscient et c’est justement pour cette raison qu’il ne faut pas s’entêter et envisager que parfois il vaut mieux se laisser conseiller, d’autant plus que d’autres résistances professionnelles extérieures mais éminentes se manifestent aussi et risquent de perdurer, ce qui pourrait isoler la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Ce qui a également beaucoup fait réagir, c’est la question des liens entre le "politique" et le "culturel". C’est un sujet sensible puisqu’on sait que les dictatures ont mis au pas et à leur service les arts et la culture avec les conséquences que l’on connaît. Nous ne sommes pas en dictature et, dans une démocratie, le principe qui prévaut est le suivant : le pouvoir politique se donne comme devoir et comme honneur de mettre en place les conditions qui favoriseront le développement des arts et des lettres ainsi que des différentes institutions culturelles, mais qu’il laissera cette création et cette vie libres, même et surtout si elles sont critiques... Personne ne veut une culture d’Etat. Bien sûr, l’exigence que nous avons rappelée ne se vit pas sans certaines tensions. Ainsi, par exemple, l’exposition Hirschhorn à Paris, dans la Maison de la culture suisse... Pour l’essentiel, la Suisse y était représentée en miniature dans une sorte de labyrinthe avec ses trains, ses montagnes, ses vaches, ses montres et son chocolat, sa presse libre et sa Constitution...
Mais le tout se fait progressivement envahir et recouvrir par des "signes" (affiches, titres de journaux...) portant les sigles et les thèmes de l’UDC. Question de l’artiste : Pourquoi et pour ...quoi ?
Cette sorte de mise en évidence critique n’a pas été comprise ou l’a trop été. Résultat, le Parlement, au nom de qui paie commande, a coupé une partie des subventions de Pro Helvetia. Sommes-nous dans une situation et une perspective semblables à La Chaux-de-Fonds ? Pas vraiment, d’ailleurs le CC s’en défend avec vigueur et c’est à saluer. "Il ne veut pas,dit-il, contrôler la culture en tant que telle. Cependant, sa démarche reste ambigüe.
En effet, le rapport dit en p. 27 :
1. "Le "politique" se réapproprie les musées.
2. Le "politique" réinvestit le savoir.
3. Le "politique" met en place des instruments de contrôle.
4. Le "politique" fixe des buts et des objectifs".
Les points 3 et 4 ne sont pas commentés. Le point 1 l’est de la façon suivante : "création de nouvelles hiérarchies qui, de fait, abrogent l’autonomie des musées". Et le point 2 : "institutionnalisation d’instruments d’information"...
Lecture unanime : c’est une mise au pas du culturel par le politique et c’est un dangereux glissement !
Lecture unanime ? Non ! Ce n’est pas celle du CC qui déclare, malgré ce qui est écrit, n’avoir pas cette volonté... Mais il doit bien y en avoir une tout de même... Laquelle exactement ? Elle est décrite dans le rapport...
Il a voulu et veut :
a) uniformiser (et non unifier) les musées
b) dissoudre les commissions de gestion qui empêchent les procédures décisionnelles
c) mettre une supérieure hiérarchique aux conservateurs, lesquels ne sont plus chefs de service
Voilà pour l’instrument, lequel doit être au service d’une "politique". Laquelle ?
Les musées seront au service "de l’image de la ville", les musées seront au "service du public" et il faut qu’il y ait des "retours sur investissements" (fréquentation notamment). Très manifestement, il y a là une instrumentalisation... Laquelle, au surplus, ne s’est pas faite selon les règles de la transparence la plus élémentaire.
Au départ, il s’agissait de réorganiser, avec la collaboration des conservateurs, l’administration des musées afin qu’ils puissent mieux accomplir leurs tâches spécifiques, ce qui n’est toujours pas fait, de telle sorte que nommés à 80 %, ils travaillent toujours à 100 %, voire plus... Mme Evéquoz a été nommée "cheffe de projet" mais le projet a changé, elle devait "observer" et j’imagine "parler avec", ce qui ne s’est pas réalisé puisqu’elle exclut les conservateurs. En silence ensuite, alors qu’elle n’avait pas encore rendu son rapport tant attendu, elle est nommée "cheffe des musées". Puis son rapport est diffusé avec le succès que l’on sait...
A sa décharge, la méthode d’analyse choisie par le CC la mettait dans une situation difficile, voire impossible, comme le reconnaît le CC, car personne ne sait, ni elle-même, si elle est "extérieure" ou "intérieure", ce qui rend problématique le regard qu’elle est censée porter... Mais avoir pensé résoudre la situation en la nommant "cheffe" montre bien l’illusion méthodologique dans laquelle se trouve le CC ou au contraire sa non volonté de porter réellement un regard et de construire ensemble.
Comme l’a bien indiqué M. Nicolas Babey, professeur, un consultant aurait mieux convenu puisqu’une telle instance est clairement extérieure, qu’elle peut faire s’exprimer et écouter, puis mettre en relation les protagonistes pour construire les uns par les autres une position meilleure...
Voilà qui est à la décharge de Mme Evéquoz.
A sa charge (et à celle du CC) cependant, un rapport non scientifique, qui n’est qu’un plaidoyer pro domo (c’est l’inertie, la paralysie, il faut un(e) chef(fe), ...)
Plaidoyer au demeurant qui ne respecte pas des règles déontologiques élémentaires (extraits de procès-verbaux sortis de leur contexte, arbitrairement coupés et assemblés par collage pour donner l’impression d’un "chaos" et surtout rendus illégalement publics...)
Il est de même navrant de voir le CC et en particulier l’un de ses membres critiquer de façon injustifiée ses ex-collègues responsables de la culture. Il les accuse "d’immobilisme" alors que lui-même fonce, certes, mais (dans ce domaine) dans un mur... Il les accuse de ne pas avoir assez rencontré les conservateurs (ce qui est parfaitement faux) alors que le CC actuel les a exclus et les dénigre. Dans le rapport, rien n’est dit de leur travail véritable.
Par contre, il est affirmé "que le métier de conservateur ne correspond pas à une formation particulière, que c’est une profession qui n’est pas définie par un profil clair, qu’ils sont des gardiens du temple et en tant que tels intouchables, qu’ils ont le savoir qu’ils placent en antinomie avec le pouvoir pour asseoir leur pouvoir".
Je reviendrai plus loin sur le profond travail qu’ils ont effectué et effectuent non pour eux-mêmes mais pour la Ville, et me contenterai de dire qu’ils sont extrêmement bien formés et qualifiés, et qu’eux ont été nommés suite à une procédure exigeante...
Ils ont un savoir, en effet, et il est vrai que le savoir confère un pouvoir : heureusement, car cela empêche certaines dérives que souhaiteraient des gens pressés... Disons encore que question d’abus de pouvoir, ce rapport respire l’autoritarisme. Enfin, dernière question, comment pourra-t-on ensuite travailler avec des personnes qu’on a à ce point méprisées et dénigrées ?...
Il reste qu’il faut en effet réfléchir sur la place de la culture dans la cité...
Une cité sans culture serait une cité sans mémoire, sans interrogation sur elle-même, sans visage, et ne serait donc plus une cité. Mais la cité a aussi d’autres tâches à accomplir pour qu’elle soit une vraie cité. C’est pourquoi la culture ne peut être toute la cité et qu’il ne faut pas opposer les tâches entre elles (par exemple dépenser pour rénover nos canalisations n’est pas moins noble que de développer notre bibliothèque), mais chercher le meilleur équilibre, l’harmonie, et cela dans le temps...
C’est pourquoi le débat toujours repris est nécessaire... entre les domaines et à l’intérieur de ceux-ci...
Les musées ne sont pas le tout de la culture institutionnelle et celle-ci n’est pas le tout de la culture puisqu’il y a par exemple le soutien à la création et à la vie associative...
Cela demande qu’on se parle, qu’on s’écoute, qu’on se respecte et que l’on construise ensemble durablement...
A mon avis, il ne faut pas uniformiser mais unifier : les spécificités sont une richesse pour élaborer un tout en mouvement. Travailler ensemble est donc nécessaire, et ce sous la responsabilité du titulaire du dicastère... Voilà ce qui s’est fait dans notre Commune et, contrairement à ce que l’on avance parfois, cela n’a pas si mal réussi... C’est donc une dialectique qu’il faut construire et non simplement des "mises au pas"... Vouloir résoudre les problèmes par une hiérarchisation n’est pas à coup sûr efficace car il ne s’agit pas que de commander...
Il existe une tendance chez certains membres de l’Exécutif communal et cantonal à vouloir renforcer le pouvoir de l’Exécutif, d’où par exemple cette volonté dans certains domaines comme les écoles de supprimer les commissions de gestion et ici celles de nos musées...
Elles seraient un obstacle au processus décisionnel...
Je ne partage pas ce point de vue. Pour moi, ces commissions sont un bon intermédiaire à l’intérieur même du législatif d’une part, et entre le législatif et l’exécutif d’autre part. Elles permettent à bien des citoyens et citoyennes de mieux connaître un domaine et de faire leur apprentissage en politique... Enfin elles sont lieu de réflexion et de débat, de telle sorte que même leurs résistances sont très souvent un enrichissement parce qu’elles permettent de mieux penser un problème...
Venons-en maintenant à la "politique" qui est proposée "Les musées doivent être au service de l’image de la Ville, les musées doivent être au service du public"...
Première question : en quoi ne l’ont-ils pas été jusqu’à maintenant ?
La réponse se fait attendre. Mais peut-être faut-il comprendre ces priorités imposées de la façon suivante : la culture doit se mettre au service de "l’image de la ville", c’est-à-dire de sa promotion économique et de son service de l’urbanisme ?... Quant à l’expression "au service du public", pour la saisir il faut la relier à la nécessité des "retours sur investissements".
Entre les deux services, il est judicieux que s’établissent des collaborations et des synergies. Mais il ne faut pas que l’un prenne le pas sur l’autre et les musées doivent pouvoir continuer d’assumer librement certaines de leurs missions spécifiques...
Des expositions à thème commun comme "Mon Beau Sapin" consacrée à l’Art Nouveau et qui connut un beau succès peuvent marquer des moments importants et en ce sens, elles sont nécessaires mais faut-il que ce soit là la seule direction... ?
Encore une fois, tout doit se jouer dans un équilibre et c’est pourquoi, par exemple, je souhaiterais que la déléguée culturelle fasse partie du dénommé "comité de pilotage"...
Maintenant comment comprendre l’expression "au service du public" ?
Si on l’associe à celle d’une "nécessité de retours sur investissements", on se dit que la priorité proposée est celle d’expositions "grand public" à large fréquentation. Bien sûr, voilà qui n’est pas à exclure mais ce ne peut être pour un musée la seule priorité... Il ne s’agit pas pour lui de satisfaire les goûts immédiats et de "vendre" des produits leur correspondant, mais essentiellement de "former" des publics, ce qui demande du temps. Le pire des élitismes, c’est au fond de flatter les gens en les laissant comme ils sont, en ne leur proposant pas de questionnement, de mise en question...
Un des mérites de Paul Seylaz, outre le fait qu’il a mis notre musée en relation avec d’autres grands musées, c’est d’avoir fait subtilement découvrir à notre public chaux-de-fonnier, plutôt attaché à l’art figuratif, l’abstraction lyrique française et italienne. Les oeuvres présentées et achetées sont d’une telle beauté, d’une telle sensibilité qu’elles touchent maintenant quasi tout visiteur...
Prenons maintenant le cheminement qu’a proposé Edmond Charrière. Sa première grande exposition "Olivier Mosset 1985" fut un choc parce que ce peintre rompt la relation sujet-objet, spectateur-tableau... Mosset construit son tableau en déconstruisant, en empêchant les projections que "tout naturellement" le sujet met dans l’objet, de telle sorte que chez Mosset, l’objet réapparaît comme tel, c’est-à-dire frontalement comme tout autre...
Edmond Charrière a pris un risque mais ce risque fait partie de son devoir de conservateur, à savoir confronter notre public à une tendance certes récente mais qui appartient déjà à l’histoire de l’art.
Mais confronter, c’est aussi reprendre et si vous regardez comme moi, par exemple cette oeuvre intitulée "Plante" de Paul-André Ferrand, vous éprouverez avec les yeux et l’esprit dans la blancheur de ce monochrome, dans son épuration et son fragile équilibre, la mystérieuse relation entre le visible et l’invisible, thème si présent dans ce que Paul Seylaz a proposé.
Le travail d’Edmond Charrière a consisté à mettre en relation l’abstraction mais aussi la figuration qu’il n’a pas du tout écartée, l’ici et l’ailleurs, le présent et le passé. Enfin il a ouvert le musée à la photographie, à la video, à l’infographie, au théâtre et ... aux dessins d’enfants. Avec le recul, on voit encore mieux toute sa riche et patiente démarche... Nous lui en sommes reconnaissants et, sans doute, les autorités aussi... Enfin, elles devraient l’être.
J’ai critiqué l’objectif dans le rapport qui me paraît le plus dangereux. Ce que j’ai dit par choix du Musée des Beaux-Arts pourrait être repris pour chacun des musées et chacune de leurs équipes...
Quant à la nouvelle conservatrice du MBA, ce qu’elle a déjà présenté est aussi varié que de grande qualité... Elle n’a pas besoin d’une "cheffe" mais d’espace temps et de moyens, comme tout conservateur.
Au moment où j’écris c’est le silence...
Mais pour sortir de l’impasse, il faudra non seulement revenir à ce qui est fondamental mais aussi résoudre un certain nombre de questions pratiques, et ce rapidement :
 la titulaire du poste de cheffe des musées peut-elle au vu de ce qui s’est passé encore l’occuper ?
la titulaire du poste de cheffe des musées peut-elle au vu de ce qui s’est passé encore l’occuper ?
- ce poste doit-il être maintenu, du moins en la forme ? Il a un coût auquel devra s’ajouter celui d’un ou une responsable administratif/ve puisque la réorganisation administrative est nécessaire, et rapidement nécessaire car les conservateurs n’en sont toujours pas soulagés.
Il y a ici un choix budgétaire à faire : mettre une somme annuelle assez importante pour un poste qui ne se justifie pas vraiment, ou la consacrer par exemple au renouvellement des collections, renouvellement lui nécessaire...
J’aimerais terminer par des propos cités dans le rapport :
"Nous voulons un musée vivant, ouvert sur la région et sur l’extérieur,, un musée qui ne soit pas réservé à une élite de gauche ou de droite, un musée qui informe et interpelle, un musée ouvert aux jeunes et aux moins jeunes, -du jardin d’enfants au troisième âge- un musée respectueux du passé et ouvert à la création contemporaine, un musée dont les Chaux-de-Fonniers se sentiront en quelque sorte copropriétaires, sans pour autant que cela entraîne des concessions au niveau de la qualité."
C’est le musée que j’ai connu et aimé. C’est le musée que je voudrais voir se continuer... et que menace la "politique" des managers.
Ce texte a d’abord été publié sur le blog Sauvons les musées de la ville de La Chaux-de-Fonds.
![]() Berne
Berne![]() Genève
Genève![]() Jura
Jura![]() St-Gall
St-Gall![]() Tessin
Tessin![]() Vaud
Vaud![]() Zürich
Zürich![]() L’Encre Rouge
L’Encre Rouge![]() La Fourmi rouge
La Fourmi rouge![]() Le Globule rouge
Le Globule rouge![]() POP-Info
POP-Info![]() Résistance
Résistance

 Manifestation samedi 15 novembre 2008, à 13 h 30, à Zurich L’arnaque, ça suffit !
Manifestation samedi 15 novembre 2008, à 13 h 30, à Zurich L’arnaque, ça suffit ! Musées de la Ville de la Chaux-de-Fonds - Analyse de Francis Stähli, conseiller général popiste
Musées de la Ville de la Chaux-de-Fonds - Analyse de Francis Stähli, conseiller général popiste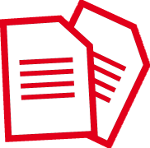
 Ville de La Chaux-de-Fonds - Rapport du Conseil communal relatif à une demande de crédit de CHF 4’700’000.— destiné à la rénovation et la transformation des immeubles sis rue Cernil-Antoine 27-29 et Louis-Agassiz 13
Ville de La Chaux-de-Fonds - Rapport du Conseil communal relatif à une demande de crédit de CHF 4’700’000.— destiné à la rénovation et la transformation des immeubles sis rue Cernil-Antoine 27-29 et Louis-Agassiz 13 Argent public détourné pour l’UBS
Argent public détourné pour l’UBS